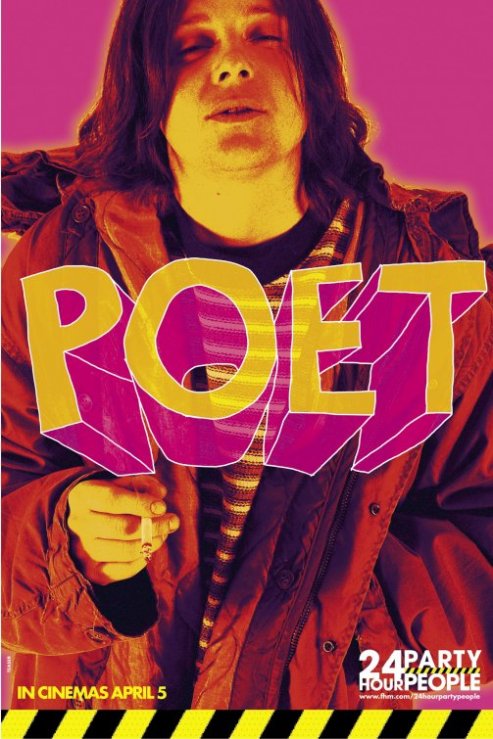Kate Spicer est journaliste, son frère Will quant à lui est réalisateur. Ils décident tous deux d’emmener leur frère Tom atteint du syndrome de l’X fragile aux Etats-Unis afin qu’il puisse rencontrer Lars Ulrich, batteur de l’un des plus grands groupes de Heavy Metal, Metallica.
Le film est assez particulier en ce sens que pendant le visionnage on a le sentiment de voir un film de famille, Kate et Will se sentent coupables de s’être éloignés de Tom en grandissant. Ceux-ci sont obligés de demander à l’entourage direct de Tom de leur faire une liste pour les aider à mieux communiquer avec lui. La partie n’est pas simple, Tom vit ses sentiments en grande partie à travers la musique de Metallica et reste hermétique à tous dialogues avec Kate . Au fur et à mesure que le périple avance, Tom refuse d’assister aux concerts et reste enfermé sur lui même. Malgré toutes les tentatives de son frère et de sa sœur. La rencontre avec Lars Ulrich est amené comme un prétexte pour que la fratrie Spicer puisse renouer des liens forts. Le court passage dédié à une spécialiste du syndrome dont Tom est atteint, aurait certainement mérité d’être plus développé. Quant à la mise en scène on ne peut pas dire qu’elle soit des plus soignées, mais il s’agit des deux seules grosses faiblesses du film.
En effet même s’il ne s’agit pas du véritable sujet du long métrage, on découvre une face cachée de la planète métal, souvent méconnue du grand public. D’une manière générale, lorsque l’on dit que l’on écoute du métal, on nous voit comme une bande de chevelus prêts à dévorer des têtes de chauves-souris (comme l’aurait soit disant fait, le frontman de Black Sabbath sur scène) ou comme les adeptes serviles de Satan. Le documentaire ne s’adresse pas qu’aux fans du groupe ou de métal, il devrait être vu par un maximum de personnes (surtout en France afin de faire évoluer les mentalités, ce message s’adresse particulièrement aux petits censeurs de joie qui réclamaient la suppression du Hell Fest, le festival de métal à Clisson).
Will Spicer a tout de même réussi à éviter une mise en scène baignant dans le mélo et d’essayer d’arracher une larme au spectateur, on y trouve de la tendresse fraternelle, de l’exaspération, de l’énervement et ce sens de l’autodérision propre aux britanniques, un film humain en somme.
Marc-Antoine Rave